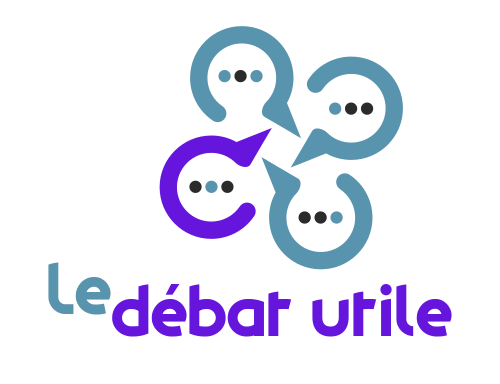La pandémie du Covid-19 et les bouleversements qu’elle a induits ont produit un effet de surprise, voire de sidération, sur les sociétés, les gouvernements, les opinions, et même sur les scientifiques. Seuls les intellectuels, par vocation sans doute, ont fait quelque peu exception: indifférents à la pandémie quelques jours avant la décision du confinement, ils ont fait preuve d’une grande réactivité pour rappeler qu’ils avaient prévu et compris ce qui se passait et qu’il savait ce qu’il convenait de faire. Comment avez-vous vécu l’événement ? Qu’est-ce qui vous a le plus étonné durant l’étrange période que nous avons traversée ?
Marcel Gauchet – Le comportement des « intellectuels » – un mot avec lequel j’ai décidément de plus en plus de difficulté- ne m’a pas étonné. « On vous l’avait bien dit »: la réaction était prévisible de la part des critiques soit de la mondialisation capitaliste, soit des dégâts écologiques de la civilisation industrielle. C’était une occasion en or de faire valoir leurs thèses sur fond du sentiment d’une catastrophe globale. Pourquoi ne l’auraient-ils pas saisie ? Ce qui m’a profondément étonné, en revanche, comme la plupart des gens sans cause militante à faire valoir, je crois, c’est le retournement subit des valeurs et des données qu’on croyait maîtresses. Nous pensions que l’efficacité économique était reine, que l’individualisme narcissico-égoïste était souverain, que l’ouverture globale avait relativisé une fois pour toutes les frontières et les vieux cadres politiques. Eh bien, pas du tout. Sans la moindre discussion, les économies ont été mises à l’arrêt, les populations ont fait montre d’une discipline collective assez remarquable, et les États-nations ont repris la main. Vérification supplémentaire : les dirigeants qui ont voulu s’opposer à cette ligne générale, des coriaces, pourtant, Johnson ou Trump, ont été obligés de s’incliner et de suivre le mouvement. Le monde à l’envers ! Comme quoi il y avait autre chose sous les apparences du fonctionnement de nos sociétés, quelque chose qui n’attendait qu’un déclic pour se manifester. Nous avons assisté à une inversion des valeurs de portée historique. Depuis toujours, la loi d’airain des sociétés était le sacrifice du petit nombre pour le bien du grand nombre – c’était encore le principe de la stratégie d’immunité collective à laquelle Boris Johnson voulait s’en tenir : quelques pertes pour un gain d’ensemble. Le choix qui a été fait, à l’opposé, a été de sacrifier la liberté et le bien-être du grand nombre pour la possibilité de sauver la vie du petit nombre. Après, on n’a pas fini de discuter de ce qui s’est joué là-dedans, mais le fait est là. Nous avons vu que l’anarchie individualiste, qu’on aurait cru indomptable, s’accommodait très bien, dans l’esprit de ses acteurs, du maintien d’une capacité civique insoupçonnée. Nous avons découvert la solidité inentamée des cadres nationaux. Rien de plus saisissant à cet égard que le vaste exode mondial qui a vu tous les soi-disant « nomades » en vadrouille à la surface du globe rappliquer vite fait à la maison, en réclamant haut et fort le secours de leurs États d’origine. Il ne fallait pas croire les apparences et leurs chantres débiles. Nos sociétés cachaient quelque chose et se racontaient des sornettes à leur propre sujet. Au boulot maintenant pour déchiffrer ce qui est apparu derrière ce rideau déchiré.
Deux interprétations s’opposent pour caractériser ce qui nous est arrivé: certains y ont vu une crise « systémique », prédisant un « après » radicalement différent; d’autres, à l’inverse, banalisant l’événement, considèrent qu’on a eu affaire à une simple et contingente crise sanitaire provoquée par « un virus sans qualité », comme dit Houellebecq, dont il s’agira d’amortir les conséquences économiques fâcheuses afin de pouvoir rétablir au plus vite le statu quo ante. On pressent que la vérité se situe quelque part entre ces deux mises en perspective. Quel jugement votre regard d’historien vous conduit-il à porter sur la nature et l’impact de la crise ?
Marcel Gauchet – Il est aussi absurde de croire que rien, après, ne sera plus comme avant, que de penser que tout va gentiment repartir comme par devant. Le propre d’une mise à l’arrêt aussi exceptionnelle des sociétés – du jamais vu dans l’histoire en temps de paix – est de susciter l’illusion d’un nouveau départ possible, d’un redémarrage à zéro, comme si nous avions la possibilité de redéfinir entièrement les règles du jeu. Les contraintes du redémarrage vont se charger de dissiper très vite cette illusion lyrique de toute-puissance. Pour commencer le choc intellectuel et moral de ce qui s’est passé va faire son chemin petit à petit dans les esprits. Ce qui s’est révélé dans la surprise ne va pas se réenfouir d’un coup sous la surface. Les leçons de l’évènement vont entrer dans la conscience des acteurs. Cela va devenir autant de données avec lesquelles compter. Et puis bien sûr la crise économique va entraîner des changements dont personne à ce jour n’a l’idée, ni la mesure, ni le contrôle. L’après va être un combat de titans entre les forces qui dominaient l’avant et qui vont tout faire pour reprendre les choses en main et la nouveauté des circonstances et des aspirations qui ont percé dans la crise sanitaire et qui vont se cristalliser dans la crise économique. Il est douteux que le capitalisme financiarisé sorte intact de l’incroyable mobilisation de ressources qu’il a fallu opérer pour tenir le choc, comme il avait réussi à le faire à la suite de la crise financière de 2008. Si les GAFAM ont été de fait les grands gagnants de l’épisode par le concours efficace qu’ils nous ont apporté – le confinement eût été impensable sans eux, il est permis de penser que ce triomphe leur sera fatal, que ce sera une victoire à la Pyrrhus. Leur rôle est trop important pour qu’on leur laisse les manettes, comme la guerre est une chose trop sérieuse pour qu’on laisse les généraux en décider. Et puis comment croire que les Occidentaux vont persévérer dans leur naïveté aveugle à l’égard de la Chine ? Leur réveil me semble inévitable, même si leur sommeil était profond. Autant de facteurs, pour s’en tenir au plus classique, qui font du monde d’après un monde destiné à s’éloigner du monde d’avant.
On a pu souligner le contraste entre l’indifférence qui fut celle des Européens en 1968-69 à l’égard de l’épidémie de la grippe de Hong-Kong et la réaction des opinions et des gouvernements aujourd’hui, qui semblent trouver tout à fait normal de bloquer l’économie pour sauver le maximum de vies humaines. Là encore, plusieurs interprétations sont possibles. On peut y voir l’effet du vieillissement de la population et du précautionnisme que celui-ci induit nécessairement; ou bien l’effet d’un progrès de la civilisation, universel puisque les réactions semblent identiques partout dans le monde, qui se traduit par le fait de donner plus de prix à la vie individuelle. On peut aussi considérer, à l’inverse, que l’on retrouve en la circonstance une réaction humaine ancestrale de peur devant l’inconnu, en raison du caractère inédit et apparemment non maîtrisable de cette pandémie. Quelle est, parmi ces interprétations possibles, celle que vous seriez enclin à privilégier ?
Marcel Gauchet – Le paramètre crucial à considérer avant de répondre à votre question est la gigantesque transformation de nos sociétés intervenue depuis la grippe de Hong Kong. Elle explique en bonne partie la différence des attitudes. J’ai découvert l’existence de cette grippe de 1968-1969 à l’occasion de notre actuelle pandémie. A l’époque, je ne m’en suis pas même pas aperçu. Ce que nous venons de vivre témoigne par contraste de la révolution de l’information qui s’est produite entre temps. Une révolution qui a été aussi une révolution de la place du soin et de son organisation dans la société. A l’époque, je suis à peu près sûr qu’un grand nombre de malades sont morts dans leurs lits en ayant eu droit en tout et pour tout à de bonnes doses d’aspirine. Ces évolutions permettent une première conclusion : nous avons mis les économies et les sociétés à l’arrêt parce que nous avions les moyens de le faire, des moyens qui n’existaient pas ou peu auparavant, en termes de richesse collective, d’organisation, d’information. Sans ces avancées de l’intégration sociale – aurions-nous pu nous permettre de nous arrêter sans les réseaux numériques ? – rien de ce que nous avons connu ne se serait produit. Cela dit, si important que soit ce constat préalable, il n’épuise pas le sujet. Quelle part faut-il faire à l’altruisme compassionnel et à la peur égoïste dans cette réaction à peu prés unanime ? Impossible à dire, les deux pouvant fort bien se combiner en proportions variables. Ce qui paraît certain, c’est que la valeur accordée à la santé s’est considérablement accrue dans la dernière période. De bons esprits ont pu parler plaisamment d’un « droit de l’homme à vivre centenaire » et cela touche bien à un ressort latent des sensibilités actuelles. On peut parler en tout cas d’un droit inconditionnel à être soigné, qui trouve son répondant chez les soignants dans leur propre volonté de pouvoir tout tenter – volonté qui n’est pas qu’humaniste, mais qui doit également être lue comme une volonté de puissance. Et derrière tout cela, la peur qui s’est manifestée dans l’épidémie n’est pas à mon sens qu’une peur de la souffrance et de la mort. Elle renvoie à une anxiété plus large et plus diffuse tenant au sentiment de fragilité de nos sociétés, à l’impression vague, mais omniprésente qu’« on ne peut pas continuer comme ça ». Le virus a capté cette anxiété, mais il ne l’a pas créée. Il lui a juste donné l’occasion de se manifester. C’est dire que les composantes du phénomène de mentalité qui a pris le pouvoir dans cette crise sont multiples et qu’ils demandent une analyse subtile.
Le choix du confinement strict impliquait de distinguer entre les activités essentielles et celles qui ne le sont pas. Par-delà son caractère opérationnel, cette distinction est intéressante dans la mesure où elle implique un questionnement sur le sens, les valeurs et leur hiérarchie. Dans le monde du travail, il est ainsi apparu que les « activités essentielles » n’étaient pas celles qui prennent la lumière en temps ordinaire. Y a-t-il lieu selon vous de tirer de la période des enseignements sur notre condition sociale ?
Marcel Gauchet – Il y a lieu de se réjouir que le confinement ait remis à l’ordre du jour des vérités élémentaires de la condition sociale. « Il n’y a pas de sot métier », et regarder les métiers sous l’angle du seul critère du plus bas coût de main d’œuvre possible est une monstruosité du point de vue de l’utilité collective. Une société n’est pas une économie : voilà ce qui nous a été rappelé et dont on voudrait que la leçon porte durablement. C’est paradoxalement plus que jamais vrai dans les sociétés ultra-modernes dont la complexité et le degré de division du travail rendent les activités de «back-office», comme dit Denis Maillard, d’une importance vitale. Ce qui ne les empêche d’être parmi les plus mal payées et les plus regardées avec indifférence. Le développement de la noble économie numérique exige des logisticiens, des coursiers, des livreurs, tous métiers fort pénibles et néanmoins relégués dans « l’ignoble ». Le point n’est plus à établir et je suis curieux de voir comment nos économistes vont se débrouiller avec leur promesse, le cœur sur la main, de reconsidérer cette injustice. Car l’utilité sociale ne se calcule pas selon les lois du marché du travail. Dans l’autre sens, tout ne se réduit pas à des tâches irremplaçables. Il ne faudrait pas tomber dans un basisme du genre khmer rouge pour lequel le port des lunettes signalait une flagrante inutilité sociale ! Je n’en prends qu’un exemple : l’utilité des chercheurs scientifiques est tout sauf évidente, mais elle n’en est pas moins considérable, sans être vraiment mesurable. Peut être est-ce la raison, du reste, pour laquelle ils sont généralement mal payés, eux aussi, un peu mieux cependant que les soutiers, et en étant mieux considérés. Evoquons même une figure diabolique, celle des financiers. On peut tout à fait discuter des émoluments que leur vaut la proximité de la caisse, mais pas de l’importance de leur rôle. Il est lui aussi vital. Ce dont nous avons besoin, en vérité, c’est d’une reconsidération du fonctionnement de nos sociétés en dehors du calcul économique. Il est indispensable, mais son élévation en critère suprême engendre des déformations aberrantes. Comment avons-nous pu à ce point perdre de vue la réalité concrète de nos sociétés au profit d’une vision abstraite, vision complètement décalée de ce fait par rapport aux critères intuitifs de justice de tout un chacun ?
Autre grand sujet débattu: la difficulté de concilier l’impératif sanitaire avec l’idéal de la liberté. Nombre d’intellectuels se sont élevés contre les implications liberticides du « sanitarisme ». De fait, il a fallu sacrifier pour un temps des libertés jugées fondamentales, comme la liberté d’aller et venir et les libertés économiques, sans même évoquer les intenses débats autour de la perspective du recours à l’intelligence artificielle pour l’organisation du « traçage des cas contacts ». Quels sont vos partis-pris sur ces questions ? Comment convient-il de poser le problème ?
Marcel Gauchet – Cette discussion est normale, inévitable et impossible à clore. Ceci posé, la bonne manière de l’éclairer dans la mesure du possible est de revenir sur les sources qui ont concouru à la rendre aussi enflammée. Car dans le principe, la suspension temporaire de certaines libertés (pas de toutes, point crucial, on va y revenir), par l’autorité légitime, en fonction d’une nécessité collective indiscutable, n’a rien de choquant. C’est bien ainsi, d’ailleurs, que la mesure a été reçue par la grande majorité de la population et mise en œuvre avec une discipline au total assez remarquable. C’est plutôt le discours d’accompagnement et les modalités d’exécution qui étaient faits pour susciter de justes critiques. Pour commencer, ces décisions ont été prises dans la panique, de manière peu réfléchie, sans une quelconque délibération de nature à les éclairer – mais c’est la loi de l’urgence- et surtout, point le plus contestable, en jouant sur la peur au lieu d’en appeler à la responsabilité personnelle des citoyens. Choix utilitaire témoignant de la défiance des gouvernants à l’égard de la société dont il ne faut pas s’étonner qu’il provoque en retour la défiance des gouvernés à l’égard des pouvoirs. Cette défiance d’en haut s’est logiquement prolongée dans une organisation bureaucratique tatillonne, support désigné pour la bêtise et l’arbitraire gendarmesque, que je suis le premier à avoir ressenti comme aussi exaspérante qu’absurde. Ah, nos belles « attestations dérogatoires » et autres dispositions courtelinesques ! Nous nous en souviendrons longtemps. Nous allons les garder pour les encadrer ! Là-dessus, matraquage médiatique aidant, une couche de moralisme sentimental pour désigner les réfractaires à la vindicte publique et faire taire les timides, qui, en effet soulevait le cœur de quiconque a le sens de la dignité des êtres de raison. Mais justement, tout cela, nous avons gardé la liberté de le dire haut et fort, de le diffuser, de le publier, et c’est le point essentiel. Nous avons fait l’expérience que la liberté la plus cruciale est celle de penser, de dire et d’échanger. Celle-là n’a été à aucun moment en cause et c’est ce qui rend ridicule les parallèles avec je ne sais quel « état d’exception ». Je veux bien que les autorités m’assènent des âneries pénibles si j’ai la possibilité de le leur crier à la figure. Or les vrais pouvoirs liberticides, eux, savent bien que c’est par là qu’il faut commencer, en organisant un silence implacable de la société. Nous n’y avons pas été, nous n’y sommes pas. Ne nous privons pas d’accabler les maladresses et les aberrations des ronds de cuir qui nous gouvernent, sachons en rire, surtout, mais sans nous croire obligés de monter sur nos grands chevaux.
Il est difficile de commenter les décisions gouvernementales sans tomber dans le biais rétrospectif. Il faut bien entendu tenir compte des données qui ont rendu la tâche des gouvernants particulièrement délicate: la rapidité surprenante avec laquelle l’épidémie a pris un caractère exponentiel, l’incertitude des données scientifiques et la double contrainte sanitaire et économique. On ne peut cependant se départir de deux impressions contradictoires. D’une part, il est clair que le gouvernement a fait ce qu’il a pu avec les moyens du bord : n’importe quel autre gouvernement aurait sans doute pris les mêmes décisions relatives au confinement et au déconfinement à quelques détails près, certes importants, qui ont fait l’objet de discussions (fallait-il maintenir les élections du 15 mars ? Fallait-il rouvrir les écoles dès le 11 mai ?). D’autre part, le constat s’impose d’une «étrange faillite»française, symbolisée notamment par l’incapacité de fournir des masques adéquats aux soignants et par les palinodies des ministres et du Directeur général de la Santé sur l’utilité du port du masque par la population. Comment démêlez-vous ces impressions ? Comment juger la gestion de la crise par le président et son gouvernement ? Quels sont selon vous les réussites et les échecs à souligner ?
Marcel Gauchet – Entièrement d’accord: l’indulgence est de mise à l’égard de ce qui ne pouvait être qu’une improvisation en situation de grande incertitude. Va pour les circonstances atténuantes. Il n’empêche que nous avons été témoins de cafouillages coupables et peu excusables. Ils s’expliquent par le croisement de deux facteurs : la prétention politique, aggravée par la déformation présidentialiste française, et l’impéritie bureaucratique, démultipliée par les réformes néolibérales de l’Etat – la RGPP sarkozyenne de sinistre mémoire. Le gouvernement était pris au dépourvu par une situation qui n’avait pas été anticipée, à tort ou à raison, on va y revenir. Il manquait de moyens. Soit. Mais dans une vieille logique de l’autorité, il fallait qu’il fasse semblant de contrôler les opérations. L’infaillibilité présidentielle était en jeu. Le chef devait avoir l’air d’en être un. D’où le choix du mensonge pour dissimuler l’impuissance. Il fallait faire semblant « d’avoir une stratégie », selon les paroles inoubliables du Directeur de la santé, pour habiller l’absence de masques et de tests. Cette posture supérieure pouvait fonctionner à une époque où des sociétés peu éduquées et mal informées se satisfaisaient de s’en remettre à des autorités tutélaires. Cette époque est révolue. Le niveau d’information et d’éducation de nos sociétés rend ce genre de prétention intenable. C’est une véritable leçon de politique qui nous a été administrée. Ce qu’on peut reprocher à un gouvernement qui prétendait incarner la modernité, c’est de l’avoir ignorée, de s’être montré aussi désespérément vieux jeu. Résultat : paralysie des initiatives qui auraient pu réparer les défaillances en urgence. Hors de question de contredire la ligne définie par le Président de la République. Et la pire des stratégies: la stratégie de la peur pour éviter les questions gênantes au lieu de faire appel à la responsabilité individuelle et collective.
A cette défaillance d’en haut est venue s’ajouter une série de dysfonctionnements de l’appareil administratif. Dans le principe, ces dysfonctionnements n’ont rien d’étonnant ; l’administration se retrouvait à ses différents niveaux devant ce qu’elle sait le moins faire, et c’est normal: gérer l’imprévu. Une administration est faite pour gérer le prévisible par des règles et des procédures, c’est sa nature. Elle applique ce qu’elle connaît. Ce pourquoi une administration a besoin d’être commandée politiquement. La tendance spontanée, devant un imprévu majeur, c’est la défausse généralisée, la bonne décision étant l’absence de décision dans l’attente d’ordres clairs. Résultat : paralysie, retards, le tout aggravé par la complexité des circuits de décision et la prolifération hallucinante des normes. Heureusement, la pression de l’opinion en haut a ramené les gouvernants à une attitude plus sensée, comme le courage et le bon sens d’un certain nombre de responsables et d’acteurs du système administratif ont permis de redresser la barre en contournant le carcan des textes. Mais à tous les niveaux, c’est une lutte contre l’inertie des recettes toutes faites qui a permis de limiter les dégâts, il faut en être conscient.
Il faudra mettre à plat tous ces dysfonctionnements. Pas pour les sanctionner, mais pour s’instruire et en tirer les conséquences. Ce serait le moment idéal de mettre en œuvre à grande échelle cette méthode inventée par l’aviation civile et qui me semble représenter un formidable progrès de la conscience commune : le signalement des problèmes rencontrés et des fautes, sans sanction et sans autre but que de mettre au point les moyens de les éviter à l’avenir. Là, nous tirerions parti des erreurs qui ont été commises. Alors que le règne de « l’envie du pénal » qui nous menace ne nous mènera qu’à une confusion supplémentaire. S’il y a une chose à combattre aujourd’hui, c’est bien cette avocasserie généralisée qui se profile.
La science a fait une irruption soudaine et spectaculaire dans le débat public à l’occasion de cette pandémie, les décisions du pouvoir comme les critiques de ces décisions paraissant suspendues à l’état d’un savoir en évolution constante et rapide. L’opinion a pu découvrir la réalité complexe de la fabrication de la vérité scientifique, les partis-pris contradictoires des savants et le fait que le savoir scientifique consiste d’abord dans « le savoir explicite du non-savoir », pour reprendre la formule d’Habermas. Le gouvernement semble avoir eu quelque peine à gérer cette incertitude scientifique, oscillant entre la tentation de s’abriter derrière l’expertise scientifique, voire de l’instrumentaliser, et la volonté de s’en démarquer, au moment de la décision du déconfinement. Comment appréciez-vous, à la lumière de ce qui s’est passé, la nature des rapports entre science et politique et ce qu’ils devraient être ?
Marcel Gauchet – Attention à l’emploi trop général du mot de «science» en la circonstance. Car c’est à une «science» très particulière que nous avons affaire, une science appliquée, la science médicale; tellement appliquée, d’ailleurs, qu’il vaut mieux en parler au pluriel : les sciences médicales. Des sciences qui s’appuient sur des connaissances tout ce qu’il y a de scientifiques, mais dans un but pratique qui les met à part : soigner des gens, y compris en tâtonnant quand la connaissance scientifique trouve ses limites. Ce qui explique les clivages entre les praticiens et les technocrates de la science dont nous avons été témoins. Grand problème épistémologique ! Mais pour en revenir au politique, il est facile de comprendre comment des pouvoirs en quête de légitimité dans une situation déconcertante ont pu avoir la tentation de s’abriter derrière une autorité qui leur semblait indiscutable. Tentation vite battue en brèche, parce que la science, et surtout celle-là, n’est pas seulement accumulation des acquis de la science faite, mais aussi discussion des hypothèses de la science se faisant. Mais surtout, c’est une seconde leçon de politique qui nous a été délivrée, le rôle du pouvoir est ailleurs et lui interdit de se retrancher derrière des avis, même les mieux autorisés. Il doit les prendre en compte, mais en les inscrivant dans un cadre bien plus large. En l’occurrence, il avait à se préoccuper de l’impact économique des préconisations des médecins, mais aussi des conditions d’existence des populations confinées et de leur état moral. Nous avons eu à redécouvrir, si nous l’ignorions, que la politique, c’est la responsabilité de la vie du tout social, et donc l’arbitrage entre des considérations qui s’opposent, le compromis entre des impératifs contradictoires. C’est ce qui en fait un art et le plus difficile des arts. « Sauver des vies, quoiqu’il en coûte », très bien, mais en n’oubliant pas que ce coût devra être réglé.
L’une des énigmes de cette crise concerne précisément le rôle politique du savoir. Paradoxalement, cette pandémie liée à un virus émergent provenant d’une zoonose, qui a surpris tous les gouvernements occidentaux, avait été prévue de longue date, anticipée de manière très précise dans de nombreux rapports. La prospective fondée sur la connaissance scientifique semble manifestement inutile. La connexion entre les prévisions à long terme et le court-termisme de la politique ne se fait pas. Est-ce une fatalité ? Peut-on concevoir des remèdes à cette déconnexion ?
Marcel Gauchet – La question que vous posez est en fait celle de l’organisation de nos systèmes gouvernementaux. Nos États sont armés de puissants outils de connaissance qui auraient pu en la circonstance leur donner les moyens de faire face à la pandémie, mais en pratique l’action des gouvernants est happée par la réaction à des urgences de court terme. Des urgences qui sont fonction pour la plus grande partie de leur souci démocratique de répondre aux attentes de la société qu’ils représentent. Le constat de ce grand écart est un argument classique des adversaires de la démocratie. Ils peuvent plaider que seul un pouvoir qui n’est pas dans la dépendance élective de la société, un pouvoir monarchique, par exemple, est capable de gouverner en ayant le souci des intérêts collectifs de long terme. La question qui nous est posée, à nous autres démocrates, est donc de savoir s’il faut se résigner à cette myopie court-termiste des gouvernements issus du suffrage, ou si nous pouvons imaginer une organisation des pouvoirs qui y incorporerait ce surmoi du long terme. Je ne prétends pas avoir la réponse. J’ai des doutes sur une solution institutionnelle. Je tends à penser que la bonne réponse se trouve dans l’élévation du niveau d’information et de réflexion de l’opinion. Ce n’est que de la discussion civique que peut venir la pression de ces données de fond qu’aucun souci immédiat ne doit faire perdre de vue. Pas plus qu’on ne peut remédier à la démagogie et à la trahison des promesses électorales par des institutions, on ne peut balancer la propension de l’autruche à plonger la tête dans le sable par une quelconque « chambre du futur » qui ferait le travail pour nous. Le véritable espoir, en démocratie, est à placer dans l’accroissement de la rationalité collective.
La situation de crise a mis en lumière le fonctionnement et les dysfonctionnements de la démocratie française. La tendance à noicir à l’excès le tableau est peut-être un penchant typiquement français qui ajoute lui-même au mal qu’on s’efforce de décrire. Force est cependant de constater qu’il y a un problème au regard du faible niveau de confiance réciproque entre l’opinion et le pouvoir. Le pouvoir se voit reprocher à la fois son autoritarisme et son impuissance. Infantilisés, les citoyens mécontents répondent par la défiance et « l’envie de pénal », comme vous disiez. Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans le fonctionnement de notre démocratie ? Pourquoi ne retrouve-t-on pas en France la sérénité des débats et la maturité collective qui semblent régner chez la plupart de nos voisins ?
Marcel Gauchet – J’ai consacré un livre entier à ce « malheur français » et je ne prétends pas avoir épuisé le sujet. La conjoncture le fait ressortir une fois de plus : les Français se distinguent par un plus grand pessimisme sur leur avenir que les pays comparables et par une plus grande défiance à l’égard de leurs gouvernants. Je ne peux que persévérer dans l’analyse que je me suis efforcé de donner. Ce marasme tient à l’accentuation particulière que la conjoncture de la mondialisation confère à un certain nombre de traits de notre héritage historique, en ce qui concerne en particulier le rapport des élites et du peuple. Des élites qui se sont dégagées plus qu’ailleurs de leur ancrage national et un peuple plus politisé et plus ancré dans son histoire qu’ailleurs. Un niveau de censure des préoccupations populaires plus élevé qu’ailleurs. Ajoutons-y l’illusion présidentielle suscitant trop d’attentes et engendrant inéluctablement la désillusion et le ressentiment, le dégrisement à l’égard d’une promesse européenne vendue de façon mensongère comme un horizon salvateur, et j’en passe. C’est tout le parcours du pays depuis quarante ans qu’il faut mobiliser pour cerner les sources de ce malaise collectif. Je m’en tiens à la formule qui me semble résumer l’essentiel : la France a mal négocié le tournant de la mondialisation et des transformations de tous ordres qui allaient avec.
La crise du Covid a permis de prendre la mesure du primat, en dernière instance, du politique sur l’économie. Si tant est qu’on l’avait oublié, il apparaît que l’État est bien l’acteur principal et décisif en situation de crise. Il en va de même partout, de sorte que cette crise sanitaire mondiale a dévoilé les forces et les faiblesses de chacun des États, ce qui donne l’occasion d’une comparaison. Au premier abord, qu’est-il apparu de nos forces et de nos faiblesses ? On a mis en cause la centralisation, la bureaucratie, l’excès ou l’insuffisance de la dépense publique. Que faut-il penser de ces critiques ? Peut-on faire à grands traits un premier bilan relatif à l’état de notre État ?
Marcel Gauchet – Une question comme celle-là demanderait un inventaire de détail. Le problème se résume dans l’anomalie bien connue, mais qui attend toujours son explication : un niveau exceptionnellement élevé de dépenses publiques pour un niveau de performance médiocre. Où va l’argent ? On vient de le revoir à propos de notre système de santé : des dépenses équivalentes aux dépenses de l’Allemagne pour des résultats nettement moins probants. Où sont les fuites dans le système ? Ce délabrement des capacités gestionnaires de notre appareil étatique devrait être le sujet principal de la discussion civique. Pour ce que j’en comprends, l’explication me paraît être à chercher dans deux directions : une décentralisation ratée en bas et une désorganisation intéressée au sommet, sous prétexte de « réforme » de l’État, qui a donné un pouvoir et des privilèges exorbitant aux « grands corps », inspection de finances et conseil d’État, aux dépens de la coordination d’ensemble. Ce que je tiens pour sûr, c’est que notre État est à rebâtir de fond en comble.
La comparaison entre la France et l’Allemagne a été un des fils conducteurs de l’analyse de la crise. L’échec français apparaît comme tel à la lumière de la réussite allemande. Peut-être le contraste est-il exagéré : les chiffres sont encore sujets à caution et il y a sans doute eu une part de contingence irréductible à la réponse politique apportée dans le fait que l’épidémie ait sévi diversement ici ou là. Le résultat ne fait cependant aucun doute : l’Allemagne sortira de la crise moins affaiblie sur le plan économique et plus forte sur le plan politique. Pensez-vous que l’écart creusé par la crise puisse avoir des conséquences importantes sur la politique européenne ? Certains vont jusqu’à évoquer la possibilité d’un éclatement de la zone euro : un tel scénario vous parait-il crédible ?
Marcel Gauchet – Il est assez probable en effet que l’écart supplémentaire qui s’est creusé et qui est appelé à s’amplifier dans les suites de la crise entre l’Allemagne et la France va rendre le pseudo-« couple » dont les dirigeants français aiment tant cultiver la fiction encore plus improbable. Car ce n’est pas seulement sur le plan de l’efficacité publique que l’Allemagne s’est montrée plus performante. L’état de ses finances lui a permis de mobiliser des ressources très supérieures aux nôtres en vue du soutien et de la relance de son économie. Cela va se traduire dans une divergence de compétitivité accrue. La dénivellation ne pourra pas ne pas avoir de conséquences politiques. Elle rendra encore plus minces les chances françaises de faire entendre sa vision politique de l’Europe. Macron n’avait déjà pas rencontré beaucoup d’écho avec ses hymnes à la « souveraineté européenne ». Il est à craindre que son discours tombera encore davantage dans le vide. Les Français vont devoir renoncer à ce qui était leur grande ambition depuis le départ de la construction européenne et que le moment Mitterrand-Delors avait consacré : en être les concepteurs. Il se pourrait bien que cette crise marque le moment du deuil définitif à cet égard.
Quant à l’euro, je n’ai pas les compétences qui me permettraient d’en juger sur le fond. Je m’en tiens à des observations extérieures. Force est bien de relever qu’il entraîne un affaiblissement des économies du sud, pour lesquelles il est surévalué et un renforcement des économies du nord pour lesquelles il est sous-évalué. L’appel à une solidarité qui se matérialiserait par d’importants transferts des riches vers les pauvres, semble incantatoire dans ces conditions. Comment des riches de plus en plus riches pourraient-ils accepter de prendre en charge des pauvres de plus en plus pauvres ? Sauf une révolution politique qui créérait pour de bon une nation européenne dont nous serions une sorte de Corse. Il y a bien quelque chose comme une impasse dans cette situation. Une impasse qui se redouble d’une impasse politique et mentale pour les Français. Même en sachant que l’euro leur est défavorable, ils se refusent à l’idée de le quitter par peur du saut dans l’inconnu ou de l’épreuve de vérité que cela représenterait. Les problèmes que l’on s’interdit de traiter de front se résolvent d’eux-mêmes, par des crises. Attendons la crise.
Au moment où je relis ces propos, nous est annoncé à son de trompe l’accord entre Merkel et Macron pour débloquer 500 milliards supplémentaires d’aides aux zones européennes les plus touchées par l’épidémie. Quelles conclusions en tirer à ce jour ? Deux principales. D’abord que Mme Merkel est fidèle à sa ligne de conduite fondamentale, celle qui l’a conduite à l’abandon du nucléaire après Fukushima et à l’accueil du million de migrants en 2015. On pourrait la résumer ainsi : l’Allemagne a besoin de vertu. Son passé fait qu’elle doit dans les circonstances cruciales marquer sa préférence humaniste inconditionnelle. La crise européenne menaçante est une de ces circonstances. L’Allemagne ne peut que montrer qu’elle joue le jeu de la solidarité européenne. C’est à l’intérieur de cet affichage ostensible qu’elle doit poursuivre ses intérêts propres. Accessoirement, ensuite, Mme Merkel semble avoir voulu sauver le soldat Macron du ridicule de ses postures prophétiques. De son point de vue, si enquiquinant soit-il, il est encore préférable à ses concurrents éventuels. Maintenant, au-delà de l’effet d’annonce, il va falloir regarder dans le détail les modalités d’application de cet accord. C’est là-dessus que sa portée se jugera véritablement. Mais dans tous les cas, au-delà de son impact conjoncturel, il ne changera rien au problème structurel des déséquilibres internes de la zone euro. La divergence continuera de se creuser, sans qu’on aperçoive l’issue.
Par-delà les considérations fantasmatiques sur le « monde d’après », il apparaît souhaitable dans une approche réaliste d’essayer d’anticiper ce qui pourrait advenir. La pandémie, même si le fait est contingent, a principalement frappé les pays occidentaux. Paradoxalement, la Chine, d’où celle-ci est partie, s’en tire à moindres frais. Faut-il craindre que la récession économique provoquée par cette crise sanitaire ne soit pour l’Occident, et en particulier pour l’Europe, un accélérateur de déclin ? Par ailleurs, il a beaucoup été question de « démondialisation »: la crise du Covid devrait accélérer la tendance au ralentissement du commerce mondial, au raccourcissement des chaînes de production, à la relocalisation de l’activité dans quelques domaines stratégiques, comme celui de la santé; bref, la tendance à une « régionalisation » des économies. Partagez-vous ce diagnostic ? Jusqu’où est-il possible et souhaitable de « démondialiser » ? Est-ce d’ailleurs le bon terme ? A-t-on affaire à une tendance lourde et durable ou bien à des inflexions relatives dans le cours d’une histoire qui demeure celle de la mondialisation ? Quelles pourraient être les conséquences d’une telle évolution pour la France et pour l’Europe ?
Marcel Gauchet – La réponse à votre question exigerait des talents de futurologue ou de prospectiviste que je ne possède pas. Je m’en tiendrai à une mise en perspective générale. Premièrement, il faut distinguer entre la mondialisation comme fait et la manière dont ce fait est géré. La mondialisation comme caractéristique nouvelle de la conjoncture historique qui s’est ouverte depuis une quarantaine d’années est une donnée irréversible de la condition planétaire. Elle représente un nouveau mode de coexistence et de relation des communautés politiques à l’échelle globale. Un phénomène qui n’en est qu’à ses débuts et sur lequel on ne reviendra pas. Il s’enracine dans cette donnée politique majeure que je suis efforcé d’analyser sous le nom de désimpérialisation du monde. Elle définit un nouveau cadre pour la condition humaine. Maintenant, ce cadre, nous sommes libres de l’organiser et de l’aménager. Or à cet égard la plus sommaire observation montre que nous sommes en présence de deux attitudes opposées : le laisser-faire occidental et la stratégie chinoise, pour faire simple. Les Occidentaux, et les européens au premier chef, se sont montrés d’une complète naïveté, par un mélange de bons sentiments et de confiance mal placée dans leur supériorité. Ils ont trouvé en face d’eux, sans le remarquer, un partenaire qui suivait une démarche complètement différente, très réfléchie, construite en fonction de l’idée de se prémunir contre ses propres faiblesses et d’exploiter celles des autres. Une stratégie qui s’est montrée d’une remarquable efficacité. Nous sommes au moment du réveil. Nous découvrons l’étendue des dégâts que notre candeur a laissé se produire dans nos sociétés. Le remède est simple : adopter l’attitude stratégique chinoise. Non pas copier leur stratégie, ce qui serait absurde, étant donné l’écart des situations, mais élaborer la nôtre. Il n’y aura pas démondialisation, mais nous allons passer d’une mondialisation naïve à une mondialisation réfléchie, à une mondialisation pensée et organisée au-delà de la foi du charbonnier dans les vertus automatiques du libre-échange.
On peut raisonnablement prévoir que durant les deux années qui nous séparent de l’élection présidentielle de 2022, la question de la crise du Covid occupera une place centrale dans le débat public, qu’il s’agisse de faire le bilan de la crise sanitaire (si tant est qu’elle puisse se clore rapidement, ce qui n’est pas garanti) ou de débattre de la manière de gérer ses conséquences économiques et sociales. Que peut-il en résulter sur le plan politique ? Au regard de la forte défiance à l’égard du pouvoir qui s’est maintenue au plus fort de la crise, on peut faire deux hypothèses : ou bien le débat sera plus que jamais structuré par l’opposition entre les populismes et le camp de « la responsabilité », que le président Macron peut prétendre incarner et rassembler; ou bien le discrédit du pouvoir macronien sera tel qu’il rendra possible la renaissance d’une opposition droite/gauche plus classique. Cette renaissance pourrait du reste être favorisée par le débat portant sur la manière de faire face à la récession. On voit déjà se dessiner deux camps : celui des keynésiens qui plaident pour le retour de l’État et une dépense publique massive, banalisant le problème de l’endettement, et, de l’autre côté, celui des libéraux qui s’inquiètent de l’ampleur de la dette publique, dénoncent l’impotence de l’État bureaucratique et plaident pour une réforme de l’État. Comment voyez-vous le jeu politique à l’approche de la présidentielle ? Le président Macron peut-il garder la main ? Quelles sont les cartes qu’il faudrait jouer pour espérer gagner ?
Marcel Gauchet – S’il y a une chose qui me semble obscure, c’est bien la situation politique qui nous attend au cours des deux années qui nous séparent de l’échéance présidentielle de 2022. Je vois comme tout le monde un président affaibli et une majorité démonétisée, mais je ne vois pas de force d’alternance plausible La gauche de gouvernement est hors-jeu, si tant est qu’elle existe encore, tant sa contamination par la gauche radicale la rend peu crédible. La droite est en meilleure posture, mais ses prétendants potentiels sont bien pâles. L’hypothèse des revenants, Sarkozy ou Hollande n’est pas à exclure, mais semble tout de même très problématique. Et je continue de croire que l’hypothèse Marine Le Pen est exclue, par absence de confiance, jusque chez ses électeurs, dans ses capacités gouvernementales et crainte des conséquences de son élection. Cela nous amène devant un problème de fond, qui risque de devenir le problème principal des démocraties dans un avenir prochain : la difficulté de trouver des gouvernants acceptables. Ce n’est pas que les candidats risquent de faire défaut, hélas, mais que ceux que l’on voudrait voir au rendez-vous manquent à l’appel. C’est la logique du moins pire qui menace de s’installer. La production de leaders de talent ne va pas de soi et il va falloir s’interroger sur les raisons qui la bloquent.
Abstraction faite de toute considération électoraliste, quelle est selon vous la réforme qui apparaît aujourd’hui prioritaire ?
Marcel Gauchet – Aucune. Ou plutôt si : la réforme de l’attitude réformatrice, la rupture avec la fuite en avant dans la prétendue résolution de problèmes qui n’ont jamais été correctement identifiés et posés. Le macronisme aura représenté un sommet dans le genre. Il est à espérer que ses fiascos à répétition serviront de leçon. Ce dont nous aurions besoin, c’est d’un bilan honnête de l’empilement d’erreurs qui s’est accumulé depuis des décennies et d’un diagnostic en profondeur sur les difficultés autour desquelles les gouvernements successifs s’agitent comme des canards sans tête. Une société qui se ment à ce point, qui s’interdit de regarder en face les données réelles de sa situation ne peut qu’être malheureuse.